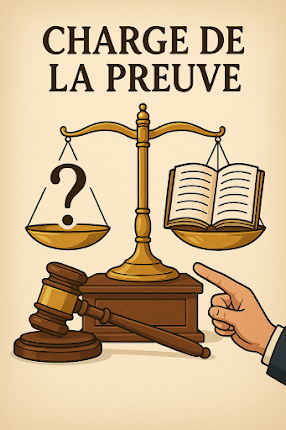Daniel Andler est une figure éminente de la philosophie française, ancien mathématicien et actuellement Professeur Émérite à Sorbonne Université, ainsi que membre de l'Académie des sciences morales et politiques.
Andler considère que les agents humains ne sont pas simplement déterminés causalement à suivre les normes et qu'ils possèdent la capacité de choisir de s'y conformer ou non. Le comportement normatif humain ne saurait être entièrement réduit à une explication purement naturaliste. Toujours pour cet auteur, si les actions humaines font partie du monde naturel, notre connaissance et notre explication de la manière dont les humains prennent des décisions dans des contextes complexes et singuliers ne peuvent être entièrement saisies par les méthodes scientifiques naturalistes actuelles.
Certes, évidemment, l'Humain, comme l'animal d'ailleurs, fait des choix, des centaines voire des milliers, tous les jours, conscients, inconscients ou réflexes. La question est justement de savoir si ces choix peuvent - même partiellement - être libres de toute détermination interne comme externe, consciente comme inconsciente. Si les lois naturelles s'appliquent toujours et partout, ce dont ne doute pas Daniel Andler je présume, il ne reste aucune place pour un libre arbitre ontologique qui défierait ces lois. Et ce n'est pas parce que "les humains prennent des décisions dans des contextes complexes et singuliers, décisions qui ne peuvent être entièrement saisies par les méthodes scientifiques naturalistes actuelles" qu'il existerait des trous spiritualistes dans la causalité. La science passe son temps à boucher ces trous avec des explications de plus en plus sophistiquées, et il faut se faire à l'idée que nous risquons de ne jamais connaître "tout" ; ce qui laisse de beaux jours aux fervents du Dieu bouche-trou ou des lacunes (Nietzsche), ainsi qu'aux asiles des ignorances (Spinoza).
Et alors ? Est-ce une raison suffisante pour passer par dessus bord le naturalisme strict, seul paradigme permettant un semblant de connaissance ? Le philosophe mathématicien Andler se pose, comme beaucoup, ce type de question : un meurtrier pourra-t-il dire au tribunal que c'est son cerveau qui a commandé son geste criminel, et qu'il faut donc soigner son cerveau plutôt que trancher la tête (ou enfermer le corps) ? Cet exemple souligne l'importance des implications éthiques, juridiques et sociétales si le libre arbitre ontologique et la culpabilité morale (et non la responsabilité) devaient être entièrement détruits par une explication scientifique purement naturaliste. La réponse naturaliste est assez simple et cohérente : oui, il faut soigner le cerveau plutôt que trancher la tête, tout en mettant hors d'état de nuire le délinquant ou meurtrier dans des conditions respectant les droits de l'humain. Il ne sera libéré que lorsque le degré de dangerosité sera jugé compatible avec la vie sociale au sens large (voir "Que faire ?")
Concernant l'IA, Andler rejette la notion d'une "superintelligence" éventuelle de la machine comme étant une croyance issue de la science-fiction, la décrivant comme un "concept faussement intangible" qui gagne une plausibilité indue par sa longue présence dans la fiction.
Andler a raison de mettre l'accent sur les différences actuelles entre l'humain et l'IA concernant les qualia, la sensibilité, les émotions - absentes chez l'IA - alors que l'Humain possède un corps sensible et une histoire évolutive, soit des compétences émotionnelles et sociales essentielles pour l'intelligence humaine. Mais rien n'empêchera à l'avenir certains spécialistes de doter l'IA de récepteurs idoines, par exemple concernant l'odorat....
Reste à savoir si ces avancées éventuelles sont souhaitables. En particulier, faire naître chez l'IA un instinct de survie comme il existe chez l'Humain (et l'Animal) pourrait - étant donné la puissance de ces machines - poser de sérieux problèmes. Chez l'Humain déjà, certains instincts fantasmés de survie et/ou de grandeur peuvent conduire à des atrocités (restauration de l'empire russe...).
Pour en revenir au libre arbitre, la mention explicite de la thèse de doctorat (encadrée par Daniel Andler) de Stefano Cossara, "Pour un quiétisme pragmatique : en finir avec le débat sur le libre arbitre", est très révélatrice de l'approche méta-philosophique de ce dernier. L'objectif de la thèse - "Dissoudre le problème du libre arbitre plutôt que de le résoudre" -, s'inspirant de l'approche "négative et thérapeutique'" de Wittgenstein qui attribue les problèmes philosophiques à une confusion dans l'usage des mots, suggère fortement qu'Andler approuve, ou du moins explore activement, une refonte du débat sur le libre arbitre. Ce "quiétisme pragmatique" implique que la dichotomie traditionnelle déterministe/libertarienne pourrait être un problème mal posé découlant d'ambiguïtés linguistiques ou conceptuelles, plutôt que d'une véritable énigme métaphysique nécessitant une solution définitive. Cela s'aligne avec son "naturalisme critique" en suggérant qu'une explication scientifique complète pourrait ne pas résoudre le problème philosophique du libre arbitre de manière directe, mais plutôt nécessiter une clarification des concepts eux-mêmes, préservant ainsi la signification pratique et éthique du libre arbitre sans avoir besoin de trouver une "solution" au sens traditionnel.
Finalement, Daniel Andler pense que le libre arbitre « réel » ontologique reste une question ouverte que nous n’arriverons jamais à cerner complètement[1]. Comme d'ailleurs Dieu, l'origine de l'univers (multivers ?), la nature "réelle" - en soi - des choses etc. Ce qui n'est pas une raison pour ne pas prendre position à partir de ce que l'on sait quand des conséquences plus ou moins funestes pour la vie (survie) humaine sont en jeu, comme c'est le cas pour cette question du libre arbitre qui ne peut pas être "dissoute"... sauf à considérer qu'il ne peut tout simplement pas exister dans un paradigme naturaliste - critique ou non - et d'en tirer les conclusions qui s'imposent !
Du fait des connaissances scientifiques que nous avons acquises avec le choix d'un paradigme naturaliste (même "critique") plutôt que spiritualiste : la charge de la preuve est du côté du croyant, ici comme ailleurs.
Et croire que l'on peut simplement dissoudre le sujet : c'est tout de même un peu court.
[1] « Quelle place pour le naturalisme dans le monde d'aujourd’hui ? » - podcast
____________________________________