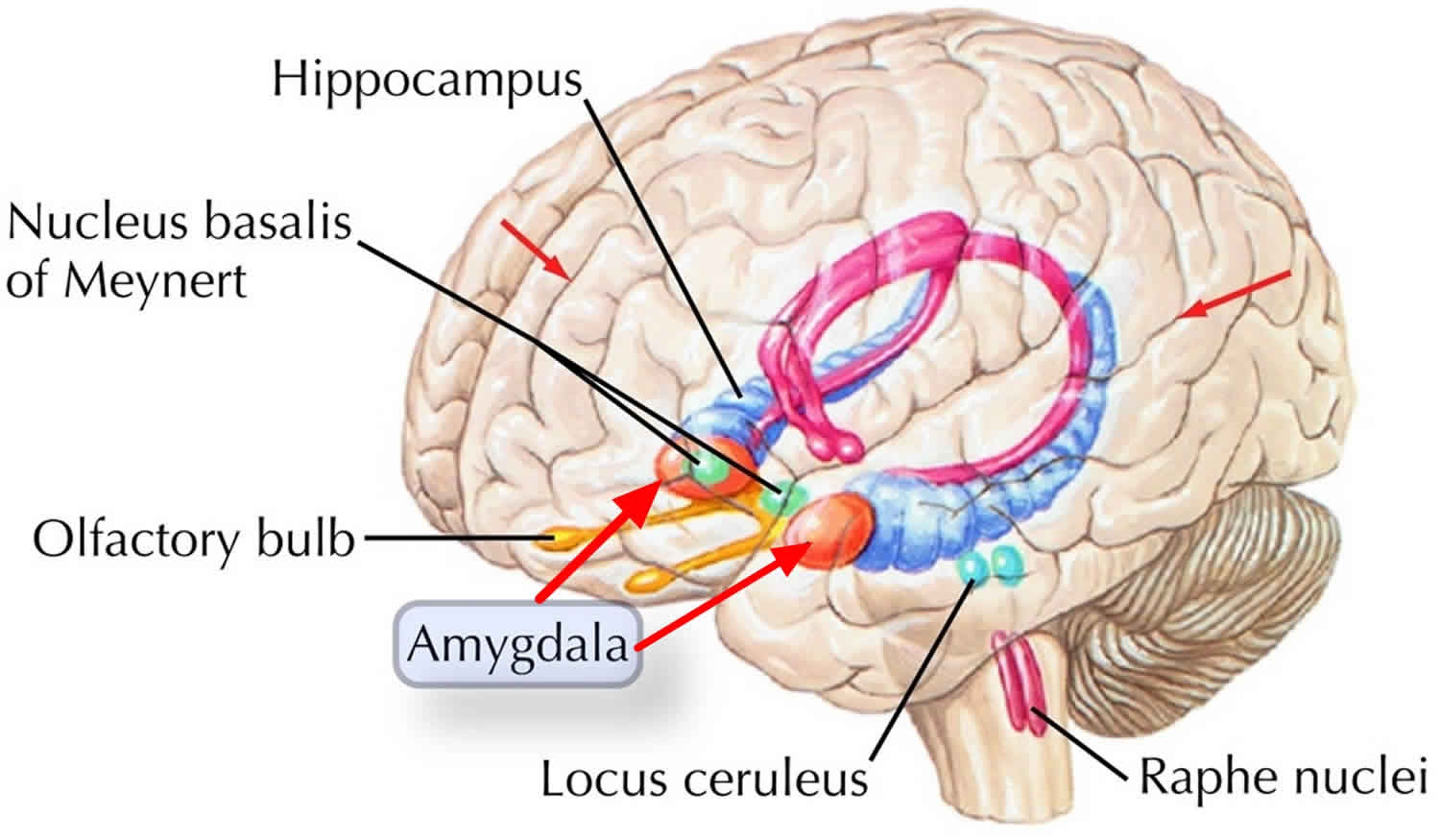La phénoménologie - une branche de la philosophie - cherche à comprendre les structures de l'expérience vécue et à décrire les phénomènes tels qu'ils se présentent à la conscience sans recourir à des interprétations ou des théories préconçues. Elle met l'accent sur la subjectivité et l'intentionnalité, c'est-à-dire le fait que la conscience est toujours dirigée vers quelque chose.
Cela dit, parvenir au cœur de la (des) phénoménologie(s)[1] est à peu près aussi simple que d’avoir une vision exhaustive et cohérente de la mécanique quantique, sans aucune excuse de scientificité.
D’autant que la visée de la phénoménologie, qui se veut scientifique sans daigner s’abaisser pour autant aux contraintes énoncées par Karl Popper[2], est élevée. Très élevée.
Heidegger s’est ainsi opposé au rationalisme de toutes ses forces :
« Je sais
aujourd’hui qu’une philosophie de la vie vivante a le droit d’exister - que j’ai
le droit de déclarer au rationalisme une guerre à couteaux tirés - sans
subir l’anathème de la non-scientificité - j’en ai le droit - je le
dois. »[4]
Selon l’agrégé et docteur en philosophie Claude Vishnu
Spaak, féru de phénoménologie :
« La
philosophie phénoménologique de la nature n’aurait guère de sens si l’on s’en
tenait au cadre des sciences de la nature et de leur scientificité héritée
du naturalisme. »[5]
Une variante sauvage pourrait donner : « la théologie n’aurait guère de sens
s’il fallait prouver tout ce que l’on affirme à propos de Dieu ». Je
ne suis pas certain que « la philosophie phénoménologique de la
nature » ainsi que la « théologie » s’en trouvent renforcées.
Comme le dit Jean Beaufret, lecteur assidu et fin connaisseur d’Heidegger, à
propos de « l’être » et de « l’étant » :
« Les
choses s’éclairent de plus en plus, c’est-à-dire... demeurent de plus en plus
nébuleuses ! »[6]
En ce qui me concerne, chaque fois que je me désespère de comprendre les propos d’Heidegger, je me rappelle cet aveu attendrissant du même Jean Beaufret qui, pendant trente ans, à plusieurs reprises, déclare avoir presque été sur le point de comprendre - peut-être - cette sentence :
« Le péril
est la menace de l’être par l’étant ».
On ne sait si son espoir a pu se concrétiser. Pour ma part, je verrais bien cette interprétation de la sentence d’Heidegger - qui sera jugée « réductrice » à n’en point douter par les zélotes phénoménologistes : les notions d’essence et de transcendance de « l’être » ont effectivement quelques soucis à se faire dans leur confrontation à l’existence ici et maintenant de « l’étant ». Le surnaturel n’est pas des plus certains !
A la lecture des phénoménologistes, j’ai souvent l’impression
(phénoménale évidemment) qu’ils enfoncent quelques portes
ouvertes et complexifient à l’envi. Carl Stumpf - philosophe qui a été le
professeur de Husserl et a dirigé la thèse de ce dernier - avait déjà quelques
inquiétudes à ce sujet :
« Pour les
lecteurs désireux de comprendre ses Idées directrices, Husserl a rendu la
tâche extraordinairement difficile dans la mesure où des exemples
adéquats, susceptibles d’éclaircir le type de connaissances qu’il a en vue,
font tout bonnement défaut. On est obligé de les chercher soi-même selon
les instructions de la théorie générale qui y est soutenue pour s’en
représenter ainsi le sens et les intentions, ce qui ne va pas,
naturellement, sans quelques incertitudes. »[7]
Une sorte de «
phénoménologie sans phénomènes » dira même Stumpf.[8]
Dans l’ouvrage « Le concept scientifique du libre
arbitre »[9],
le docteur en philosophie Albert Dechambre illustre assez bien le galimatias
conceptuel « neurophénoménologique » dans un effort assez désespéré
pour sauver le Libre Arbitre (il fallait bien que j'y vienne) :
« Le
modèle neurophénoménologique montre que le libre arbitre est possible grâce
à la dynamique des synchronisations, des trajectoires et des attracteurs, qu’il
se réalise grâce à leur plasticité et leur sensibilité à l’analyse
phénoménologique réflexive (la causalité circulaire entre niveaux). Il offre
ainsi sa sensibilité à la causalité symbolique opérant au sein des flux de
conscience des individus et des communautés. Nous pouvons ainsi réécrire le
schéma de la causalité symbolique en termes de causalité circulaire et de
cogénération entre le monde phénosymbolique et le système des inscriptions
neuronales (assemblées, attracteurs, trajectoires) grâce au sujet énacté dans
son environnement phénosymbolique et l’énaction des symboles et rapports
symboliques dans l’activité neurologique. »
On se retrouve avec la « causalité circulaire », une causalité sans cause, qui tourne en rond.
« Nous
sommes parfois libres. Cette conclusion modeste suffit car elle
est la garantie que cette liberté peut s’accroire si nous veillons sur la
richesse et la flexibilité de nos outils symboliques. Elle nous engage dans un
processus dynamique autoréflexif : de plus en plus d’actions ne sont pas
précédées de causes qui nous échappent… Cette conclusion faible peut
apparaître comme une concession faite aux sceptiques (qui ne croient pas à la liberté de la
volonté), et c’est bien le cas au sens où
dans la vie quotidienne, peu de choix sont réellement libres. »[10]
Patatras ! Cruelle déception. La conclusion est à la fois
« modeste » et « faible » ; et pas que la conclusion.
Mais alors il faudrait modifier drastiquement le titre de cet article « Preuve du libre arbitre »
par quelque chose comme : « Nous
sommes peut-être libres, enfin, parfois, enfin je ne sais pas trop pour tout
dire ». Ce serait moins marketé mais plus honnête. Le même précise concernant les sceptiques du LA comme le psychosociologue Daniel Wegner ou Libet avec son
expérience princeps :
« Il faut
convenir qu’ils ont déjà manifesté leur libre arbitre en ayant choisi le
type d’expérience avec lequel ils pensaient pouvoir réfuter le libre
arbitre. »[11]
Sophisme, quand tu nous tiens... Wegner ne
« réfute » pas le LA « réel » ; il ne le voit nulle
part et demande la preuve de son existence avant toute chose ; preuve qui ne
vient évidemment pas. Quant à faire coïncider choix et LA, l’animal effectuant également des
choix, celui-ci est donc également doté du Libre Arbitre ? Quant à Libet,
le pauvre, il voulait au contraire démontrer par son expérience la réalité du
LA !
Je comprends fort bien que l’on puisse être fasciné par une
tablette phénoménologique d’écriture cunéiforme promettant le Graal de la
connaissance et de la conscience. Le décryptage de sentences ésotériques ne
peut que passionner tous les Champollion en herbe qui se sont égarés en
philosophie. Je n’ai pas reçu cette grâce, tout comme le philosophe
Jean-François Revel qui constate...
« Le
caractère rigoureusement tautologique de la démarche de Heidegger qui, lorsqu’il
traite de l’être, se borne à nous dire que l’étant y surgit, et, lorsqu’il
traite de l’étant, nous dit qu’il ne peut se comprendre qu’à la lumière de
l’être (...) Ce qui est à prouver se
transforme insensiblement au bout de quelques lignes en preuve de l’idée qui
devait lui servir de preuve. »[12]
Toujours la circularité ! Sophisme, quand tu nous tiens...
Les agrégés de philosophie Henri de Monvallier et Nicolas Rousseau[13] n’ont malheureusement pas plus de chance que Revel : tous ceux-là considèrent la phénoménologie comme l'une des impostures intellectuelles majeures des XXème et XXIème siècles. Prônant une méthode qui se voudrait « rigoureuse » fondée sur la description des phénomènes tels qu'ils apparaissent à la conscience[14], la phénoménologie ne débouche, pour ces auteurs, sur aucun résultat probant. Cette branche de la philosophie singerait la profondeur à l'aide d'un jargon aussi incompréhensible que ridicule ; une entreprise dogmatique et autoritaire, qui impose sa vision du monde sans la soumettre à la critique, et qui méprise le lecteur en le noyant sous des formules absconses.
« Le
jargon donne l'illusion de participer à une réalité supérieure : plus on
l'emploierait, plus on s’élèverait au-dessus du niveau des simples mortels.
Mais le plus souvent il ne s’agit que de sudation intellectuelle en vase clos. »[15]
Nicolas Rousseau cite à ce propos La Bruyère qui nous
étonne avec une prescience proprement « phénoménale » :
« Une chose vous manque, c’est l’esprit. Ce n’est pas tout : il y a en vous une chose de trop, qui est l’opinion d’en avoir plus que les autres ; voilà la source de votre pompeux galimatias, de vos phrases embrouillées, et de vos grands mots qui ne signifient rien. »[16]
Bref, la phénoménologie pourrait bien être un avatar de
l’idéalisme (spiritualisme), une obstination dans l’invérifiable.
Pour le philosophe Michel Onfray, préfacier de l’ouvrage « La
phénoménologie des professeurs » :
« Il
s’agit encore et toujours de vendre des arrières-monde - ce qui, après
Nietzsche, devrait pourtant être une occupation aussi caduque que celle de
fabriquer en série des haches en pierres polies (...) Des fumées pour dissiper
des fumées »...
Et puis, une certaine promiscuité, voire une promiscuité certaine de Heidegger avec le nazisme et l’antisémitisme[17] n’est pas de nature à arrondir les angles, même s’il est de bon ton de séparer l’œuvre de l’homme qui adhéra à l’idéologie nationale-socialiste et au délire antisémite des « Protocoles des sages de Sion », un faux fabriqué par la police secrète tsariste[18].
Le même Heidegger qui a noté dans ses « cahiers noirs » récemment édités :
« L’une des
formes les plus dissimulées du gigantesque, sa forme peut-être la plus
ancienne, est la coriace habileté à calculer, trafiquer, embrouiller, en quoi
se fonde l’acosmisme[19]
du judaïsme. Le judaïsme mondial, excité par les émigrants qu’on a laissés
sortir d’Allemagne est partout insaisissable et peut déployer sa puissance sans
prendre part à aucune action guerrière - contre quoi il ne nous reste qu’à
sacrifier le meilleur sang des meilleurs de notre propre peuple. »
Bigre ! Enfin une pensée claire... qu’on regrette aussitôt d’avoir compris. Certains y verront juste une « grosse bêtise » quand d’autres y détectent l’incurie éthique et politique de la pensée de Heidegger qui mobilise les concepts fondamentaux de sa pensée (dasein, oubli de l’Être, puissance efficiente de la technique) pour les fondre, les amalgamer dans les clichés antisémites de l’idéologie nazie. Jusqu’en avril 1942, Heidegger était membre de la « Commission pour la philosophie du droit », une instance nazie dirigée par Hans Frank, « le boucher de la Pologne »[20].
Et ce n’est pas l’ancien professeur de philosophie Vincent Cespedes qui dira le contraire, lui qui a fait pétition pour supprimer Heidegger de la liste des philosophes recommandés en Terminale[21]. Cinq mille signatures ; sans suite. Mais doit-on se plier à la « cancel culture » ou plutôt reconnaître l’existant et former un jugement ? (voir Wokisme et cancel culture)
Quoi qu’il en soit, la phénoménologie n’apporte rien de fondamental au sujet qui nous occupe (vous vous souvenez : le libre arbitre), même s’il existe des recherches recueillant des données subjectives dites « en première personne » (phénoménales) couplée à des données objectives dites « en troisième personne »[23] (scientifiques) dans le cadre notamment de la neurophénoménologie initiée par Francisco Varela[24]. Reste à vérifier que la première personne apporte effectivement une aide à la troisième, comme, par exemple, la possibilité d’identifier des sensations « subjectives » prédictrices d’une crise d’épilepsie « objective » à venir[25].
Le neuroscientifique Stanislas DEHAENE ne semble guère plus convaincu :
« Transformer un mystère philosophique en un simple phénomène de laboratoire [...] Une fois que nous aurons clarifié comment l’acte de perception transforme certaines des informations qui frappent notre rétine en pensées conscientes, la montagne philosophique que nous nous faisons du caractère ineffable de l’expérience subjective accouchera d’une souris... de laboratoire. »
Trente après le début de la neurophénoménologie, je n’ai pas eu le bonheur de vérifier la pertinence de cette approche[26] dont on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une simple confusion avec la neuropsychologie, une spécialité de la psychologie qui se concentre sur la relation entre les fonctions cognitives, le comportement et le cerveau...
De même, la « philosophie de la psychiatrie » est une tentative de lier phénoménologie et psychiatrie dans un attelage des plus improbables[27].
Mais laissons les portes ouvertes !
[2]
Philosophe épistémologue, Popper a établi un critère de démarcation entre les
sciences expérimentales et les autres savoirs. Il a mis l'accent sur l'idée de
réfutabilité par l'expérimentation pour caractériser le savoir scientifique. La
phénoménologie n’est en aucune manière « refutable ».
[3] « Phénoménologie de la perception » - Maurice Merleau-Ponty : « La phénoménologie, c'est l'étude des essences, et tous les problèmes, selon elle, reviennent à définir des essences : l'essence de la perception, l'essence de la conscience, par exemple (...) C'est une philosophie transcendantale qui met en suspens pour les comprendre les affirmations de l'attitude naturelle... » - http://philotextes.info/spip/IMG/pdf/merleau-ponty-phenomenologie-de-la-perception.pdf
[4]
« Mein liebes Seelchen! » lettre à sa future épouse - 1916
[5] « Vers une philosophie phénoménologique de la nature » - Claude Vishnu Spaak https://journals.openedition.org/alter/582?lang=de#tocto1n2
[8]
« Avec ou sans Phénomènes ? La Phénoménologie entre Stumpf et
Husserl » - https://sciendo.com/pdf/10.2478/phainomenon-2017-0006
[10] https://www.academia.edu/48933648/The_Free_Will_Proof_La_preuve_du_libre_arbitre_Compl%C3%A9ment_au_concept_scientifique_du_libre_arbitre - page 38
[11]
Ibid
[12]
« Pourquoi des philosophes » - 1965 - Pauvert - p.52
[13]
« La phénoménologie des professeurs - L'avenir d'une illusion
scolastique » - 2020 - L’Harmattan
[14]
N’y a-t-il pas une grande difficulté, voire une impossibilité majeure, à être à
la fois acteur, observateur et analyste de son expérience
« consciente » ?
[17]
A quelques exceptions près : des amis juifs, Hannah Arendt... Soit des
affects à géométrie variable, comme pour nous tous...
[18]
« Les Protocoles des Sages de Sion » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Protocoles_des_Sages_de_Sion et « Lecture d’un faux
ou l’endurance d’un mythe : les Protocoles des Sages de Sion » - https://www.erudit.org/en/journals/crs/1989-n12-crs1516226/1002060ar.pdf
[19]
Terme appliqué par Hegel au système de Spinoza (par opposition à athéisme)
parce qu'il fait rentrer le monde en Dieu plutôt qu'il ne nie l'existence de
celui-ci. L'acosmisme est la théorie qui, par contraste avec le panthéisme, nie
la réalité de l'univers, ne le considérant finalement que comme illusoire.
[23]
Données dites "en troisième personne", c'est-à-dire observables et
reproductibles à l’identique par un observateur neutre
[24]
Rappelons que Husserl était des plus critiques concernant les tentatives de «
naturaliser » la philosophie
[25] « Anticipating seizure: Pre-reflective experience at the center of neuro-phenomenology » - https://clairepetitmengin.fr/AArticles%20versions%20finales/Co%20&%20Co%20-%20Anticipation.pdf
[26] « Francisco Varela’s neurophenomenology of time: temporality of consciousness explained? » - https://www.actaspsiquiatria.es/repositorio//15/84/ENG/15-84-ENG-253-262-516323.pdf