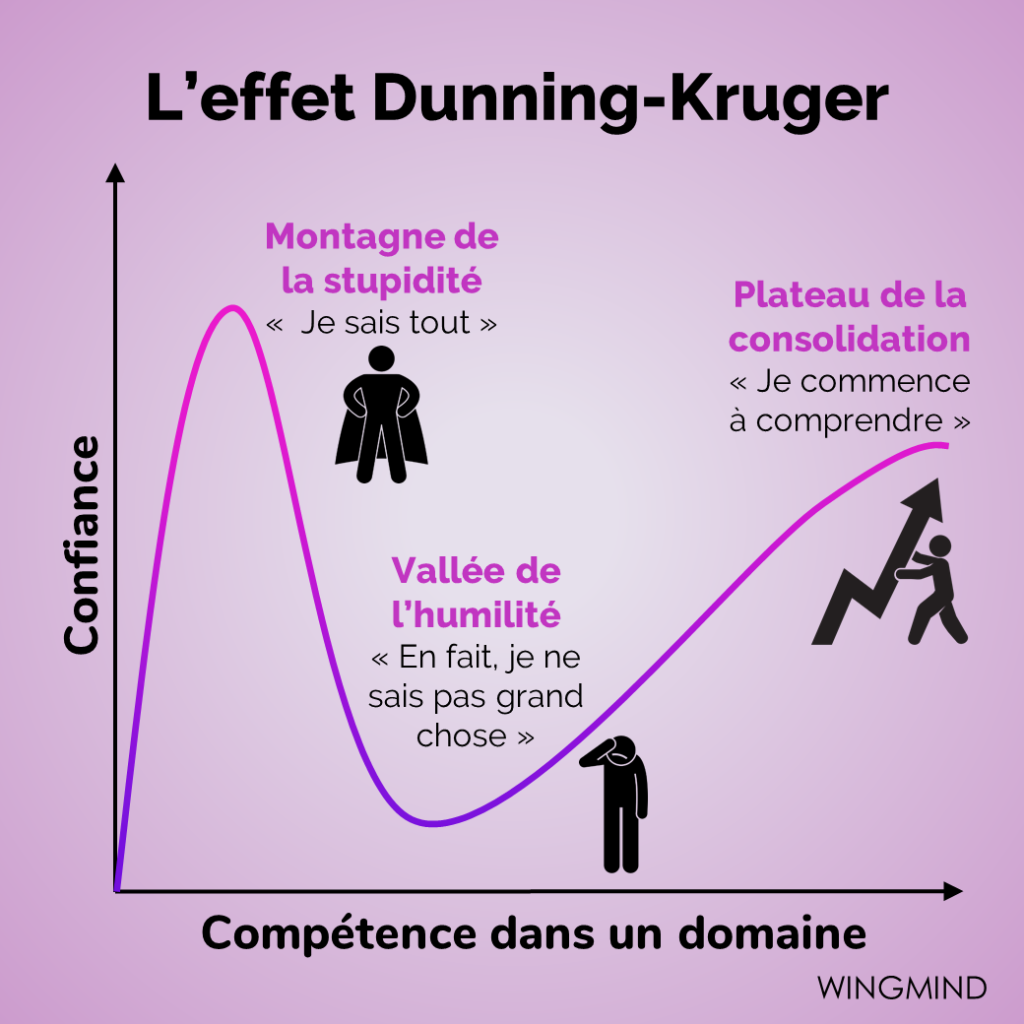Les premiers regroupements humains étaient basés sur des liens de sang et des relations familiales. Les familles et les clans offraient une protection, un partage des ressources et une transmission des connaissances essentielles à la survie.
Avec l’avènement de l’agriculture, les humains ont commencé à se sédentariser, formant des villages. Ces regroupements permettaient une meilleure organisation du travail agricole, la construction d’infrastructures communes et une défense collective contre les menaces extérieures.
À mesure que les villages grandissaient, ils se sont transformés en cités-États et en régions. Ces entités plus grandes permettaient une spécialisation accrue des métiers, le développement du commerce et l’émergence de structures politiques plus complexes.
Les régions et les cités-États se sont progressivement unifiées pour former des nations. Cette unification était souvent motivée par des besoins de défense commune, de gestion des ressources à plus grande échelle et de consolidation du pouvoir politique.
Les organisations internationales et les accords multilatéraux jouent (devraient) jouer un rôle clé dans la gestion des défis globaux comme le changement climatique et les crises économiques.
Cette progression des regroupements humains reflète une quête constante de sécurité, de prospérité et de développement. A part un accident majeur (guerre nucléaire / comète / épidémie dévastatrice etc.), on ne voit pas très bien ce qui pourrait entraver cette progression vers la mondialisation, pour les mêmes raisons de fond qui nous ont fait passer du clan à la nation. Les extravagances actuelles d'un Trump ne sont qu'un épiphénomène dans cette progression vers toujours plus de mondialisme.
Mondialisation et nationalisme sont deux idéologies opposées qui façonnent les politiques économiques, sociales et culturelles des peuples. Alors que la mondialisation prône l’interconnexion et l’intégration mondiale, le nationalisme met l’accent sur la souveraineté nationale et l’identité culturelle.
Quelques précisions nécessaires :
- Le
matérialisme, qui inclut l’idée que le libre arbitre est une illusion,
propose que nos actions et comportements sont déterminés par des causes
physiques et biologiques. Cette vision peut favoriser une plus grande tolérance. En effet, si nos actions sont déterminées par des facteurs intérieurs et extérieurs hors de portée de notre contrôle conscient, il devient plus facile de comprendre - ce qui ne veut pas dire tout tolérer - le comportement des "autres". On peut voir les actions négatives comme le résultat
de circonstances (génétique et environnement) plutôt que de choix moraux réellement délibérés. On ne peut dans ce cas pas faire autrement que ce que l'on fait (voir Peut-on faire autrement).
Universaliste, le matérialisme tend à voir tous les humains comme fondamentalement égaux, car nous sommes tous soumis aux mêmes lois naturelles. Cette perspective peut réduire les préjugés et les discriminations basées sur des différences perçues. En reconnaissant que les comportements sont le résultat de conditions de vie souvent difficiles, le matérialisme peut encourager une attitude plus empathique et compatissante envers ceux qui sont différents de nous.
- Le spiritualisme, en revanche, met l’accent sur l’importance de l’âme, de la volonté libre et privilégie l’identité culturelle (traditions). Cela peut conduire à une résistance aux influences extérieures et à une méfiance envers les étrangers qui pourraient menacer cette identité. En insistant sur des valeurs et des croyances spécifiques, le spiritualisme peut créer des divisions entre ceux qui partagent ces valeurs et ceux ne les partageant pas. Ce qui peut entraîner des discriminations envers les minorités et les étrangers (voir Wokisme et cancel culture), certaines formes de spiritualisme pouvant justifier la discrimination en se basant sur des croyances religieuses ou culturelles qui considèrent certaines populations comme inférieures ou menaçantes. Bref, un nationaliste pur jus, conservateur ou réactionnaire comme il vous plaira. Certains de cette chapelle, comme Jean-Jacques Stormay, en sont encore à réclamer "un roi légitime de droit divin" abrogeant tout de go république et démocratie ; deux fois rien. Comme le relate le site d’obédience dextre "Jeune Nation" :
"Dans la Doctrine du Fascisme catholique, Jean-Jacques Stormay nous exposait la spécificité de cette pensée politique, actuellement la seule qui sache harmoniser rationnellement les exigences de l’ordre naturel et celles de l’ordre surnaturel, du Bien commun politique et du Souverain Bien."
« Le nationalisme
c’est la guerre » disait François Mitterrand, surtout quand il devient impérialiste.
« Fier d’être
français » écrivait Max
Gallo dans son livre éponyme. Dans la définition du mot fierté, la morgue,
l’arrogance, la supériorité affichée sont très proches, sinon incluses dans le
mot. Je n’ai pas à être « fier » d’être né ici plutôt qu’ailleurs,
pas plus que d’être « fier » d’être gay, blond, blanc, noir, musclé
etc. puisque ces situations sont le fait de déterminants aléatoires. En
revanche, je peux être heureux de vivre - par un savoureux hasard - dans un
pays républicain, démocrate, où nombre de valeurs me sont maintenant chères,
même si tout ne va pas pour le mieux. Pas de raison non plus d’être fier
d’appartenir à une civilisation ou une ethnie qui se croirait
« meilleure » que d’autres. C’est ce que nous explique le géographe,
biologiste évolutionniste, physiologiste, historien et géonomiste Jared Diamond[1]
qui considère comme cruciaux certains facteurs ayant déterminé l'inégalité des
sociétés et la domination de certains hommes sur d’autres : tout d’abord la
« chance géographique », puis les armes, les germes (bactéries,
virus...) et l’usage des métaux. L’auteur réfute entièrement l’explication
génétique - qu’il considère comme « raciste »[2] -
des divergences entre les sociétés humaines. Il adopte au contraire une optique
« naturaliste » dans le sens où la géographie de l’environnement et la
biogéographie ont façonné des configurations historiques différentes dans
le cadre de la vicariance[3].
Pour Diamond, nous ne sommes dans notre chère civilisation occidentale que
les très heureux héritiers de déterminants favorables. Analyse identique
pour David Cosandey dans son ouvrage « Le
secret de l’occident »[4].
De là à être fier...
Autant les guerres de clans ne faisaient que quelques morts, autant le nationalisme à l’ère nucléaire est d’une autre nature. Les prétentions territoriales russes ont malheureusement des chances d’aboutir sous la menace de l’anéantissement du monde.
Du côté de la droite libérale toujours (il existe plusieurs droites dont celle qui a le cœur à gauche et le portefeuille à droite ; voir "Mais comment peut-on être de droite ?"), Pierre-Henri Tavoillot considère que...
« Etre de
Gauche, c’est aimer la Gauche plus que la France ; être de droite, c’est
aimer la France plus que la Droite ».
Étrange provocation. Peut-on préférer, voire même comparer
carotte et dé à coudre ? Libre-échange et pain Poilâne ? J’aime la
France d’abord parce j’y suis né, et j’aimerais très probablement tout autant
le Pakistan pour la même « raison » : affective. Mais quand je
compare les normes sociétales, je préfère la France ; c’est surtout
qu’elle m’a constituée et que j’ai pu intégrer ses normes et leur histoire.
Mais je comprends fort bien que des pakistanais puissent préférer les normes
pakistanaises car ce sont les leurs. La seule discussion possible concerne l’universalité
éventuelle des valeurs respectives : je prétends que permettre aux filles
d’étudier est une valeur qui devrait être universelle,
mais il n’est pas question pour autant de l’imposer manu militari aux pakistanais et autres peuples qui en sont là.
Aimer la Gauche et ses valeurs universalistes n’entre pas en compétition avec
l’amour du pays. Et cet amour du pays ne devrait pas se confondre avec un
chauvinisme et la fierté « d’être
français, moi Monsieur », le mépris des autres et de leur culture, quand
bien même celle-ci peut générer un certain dégoût (manger du chien) ou des
critiques légitimes en comparaison des valeurs universalistes.
Les travailleurs des pays développés peuvent perdre leurs emplois en raison de la délocalisation vers des pays où la main-d’œuvre est moins chère. L’augmentation de la production et du commerce international a entraîné une exploitation excessive des ressources naturelles et une pollution accrue. Les réglementations environnementales sont souvent moins strictes dans les pays en développement, ce qui peut aggraver les problèmes écologiques. Les États peuvent perdre une partie de leur souveraineté en raison de la pression des multinationales et des institutions internationales. Les politiques économiques nationales peuvent être dictées par des intérêts étrangers, limitant la capacité des gouvernements à protéger leurs citoyens. La mondialisation peut mener à une uniformisation des cultures, où les traditions locales sont remplacées par des cultures dominantes, ce qui peut entraîner une perte d’identité culturelle et de diversité.
Quelles seraient les solutions pour remédier aux effets négatifs de la mondialisation tout en restant dans le paradigme matérialiste, le seul socle idéologique / philosophique qui soit commun à tous les humains ?
- Mettre en place des politiques fiscales et sociales pour redistribuer la richesse et réduire les inégalités économiques.
- Renforcer les filets de sécurité sociale pour protéger les travailleurs affectés par la mondialisation.
- Adopter des réglementations
environnementales strictes, encourager les pratiques durables et promouvoir les technologies vertes et
les énergies renouvelables pour réduire l’empreinte écologique.
- Les gouvernements doivent négocier des accords commerciaux qui protègent leurs intérêts nationaux et leur souveraineté, secteur par secteur (défense, alimentaire, numérique etc.) sans aller jusqu'au délire Trumpiste.
- Encourager la coopération internationale pour réguler les activités des multinationales et garantir des pratiques commerciales équitables.
- Soutenir et préserver les cultures locales par des politiques éducatives et culturelles.
- Encourager les échanges culturels qui respectent et valorisent la diversité.
En adoptant ces mesures, il devrait être possible de tirer parti des avantages de la mondialisation tout en minimisant ses effets pervers et réduire d'autant les tendances identitaires nationalistes, royalistes, fascistes etc.
Qui va s'y coller ?
Si vous avez 20 min. à gagner, voici une vidéo intéressante montrant les tensions entre identités / particularismes et collectif / universel :
Et quelques réflexions lumineuses sur le nationalisme en cliquant sur l'image (25 min.) :
[1] « De l'inégalité parmi les sociétés: Essai sur l'homme et l'environnement dans l'histoire » - 2007 - Folio Essais et les 9 vidéos tirées du livre
[2] Quand bien même il y aurait des différences génétiques plus favorables que d’autres, nous n’avons rien choisi « librement »
[3] La vicariance « géographique » se produit lorsque deux populations d’une même espèce sont séparées par une barrière physique (montagne / mer) et évoluent de manière indépendante, donnant naissance à deux espèces distinctes. La vicariance cette fois « écologique » se produit lorsque deux populations d’une même espèce occupent des niches écologiques différentes dans une même aire géographique et développent des adaptations spécifiques, donnant naissance à deux espèces distinctes. On peut parler également de vicariance « culturelle »...